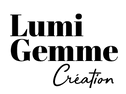Avoir ce pot en terre cuite entre les mains, toucher la matière tantôt lisse, tantôt rugueuse de ce pot appelé “ pot Hugues “, c’est plonger dans l’histoire passionnante des Landes de Gascogne. Une histoire vieille de plusieurs siècles où l’homme et la forêt écrirent ensemble les pages d’un savoir-faire précieux : le gemmage.
Une Plongée dans l'Histoire des Landes de Gascogne
Le gemmage consiste à récolter la résine de pin et cette pratique se retrouve notamment en Chine, aux Etats-Unis, Brésil, Espagne, Portugal, Allemagne…
En France, s’il date de l’Antiquité, le gemmage s’est véritablement développé au 17ème siècle pour se généraliser dans toute la forêt landaise dès le milieu du 19ème siècle, avec la fin du système agro-pastoral et les boisements intensifs, fruits de la loi de 1857, qui donnera naissance au plus grand massif forestier européen: les Landes de Gascogne.
En fonction des usages de la résine et surtout des époques, on distingue trois grandes techniques de récolte de la gemme (résine) dans les Landes de Gascogne. Leur point commun est la pratique d’une petite incision en hauteur dans le pin, une blessure qui sécrétera de la résine afin d’assurer sa cicatrisation. Après récolte, cette résine est valorisée par distillation et obtention de deux principaux constituants: environ 20% d’essence de térébenthine et 80% de colophane.
Le Gemmage : Un savoir-faire ancien
La technique du crot
La première technique, dite du “crot”, fut pratiquée depuis l’Antiquité jusqu’à l’introduction du système “Hugues”, dans la seconde moitié du 19ème siècle. Pour récolter la résine, les anciens résiniers (ou gemmeurs), creusaient un trou, le “crot” en gascon, au pied du pin. Après avoir pelé la grosse écorce, ils pratiquaient une incision dans l’arbre, la “pique”, avec une hache appelée le “hapchot”. La résine coulait jusqu’au trou. L’arbre cicatrisant rapidement, il fallait régulièrement reprendre l’incision en pratiquant , quelques centimètres plus haut, une nouvelle pique. L’ensemble de ces piques formait une plaie longue et étroite , nommée la “carre” ; celle-ci pouvait s’élever jusqu’à 4 mètres accessibles grâce au “pitey”, sorte d’échelle en bois à un seul montant. La résine recueillie contenait beaucoup d’impuretés (sable, brindilles, insectes) et lorsque la carre était haute, les principes actifs de l’essence de térébenthine s’évaporaient abondamment avant d’arriver jusqu’au trou.
Le système "Hugues"
Pour remédier à ces inconvénients et surtout pour doper une production devenue industrielle dans la seconde moitié du 19ème siècle, les résiniers vont adopter une nouvelle technique, celle du système “Hugues”, du nom de son inventeur.
Coincé entre une lamelle de zinc légèrement cintrée, le “crampon”, par dessus et soutenu par un clou par dessous, un pot en terre cuite servait de réceptacle et était dit “ascensionnel” car il suivait chaque année la montée de la carre.
Cette technique de gemmage est la plus emblématique et fût celle pratiquée à grande échelle dans toute la forêt des Landes.
La fabrication de ces petits pots faisait vivre bon nombre de potiers locaux qui les tournaient dans leurs ateliers artisanaux. A partir de la fin du 19ème siècle, les premiers pots moulés apparaissent et finiront par supplanter peu à peu dans le courant du 20ème siècle, les productions tournées. De ces petits pots en terre cuite “Hugues”, la résine était transvasée dans de plus gros pots appelés “escouartes”. C’était le travail des femmes, parfois des enfants. Un résinier devait en moyenne s’occuper de 4000 pins qui produisaient chacun environ 2.5 litres de résine par an. Son travail était difficile et peu rémunéré; il commençait à la fin janvier et s’achevait vers le début du mois d’octobre.
Les mois les plus chauds étaient ceux pendant lesquels la résine coulait le plus et celle issue des forêts du littoral était de meilleure qualité, les pins étant plus vigoureux. Par exemple, les résines de la Teste de Buch se vendaient plus cher et étaient d’excellente qualité: on pouvait en extraire jusqu’à 22.1% de térébenthine contre 19.9% à Dax et 19.5% à Mont de Marsan.
Une fois pleines, les escouartes étaient à leur tour vidées dans des barriques en métal pour être enfin acheminées vers les distilleries de résine.
Gemmage à "l'activée"
Une troisième technique fut introduite en France dans les années 50 tandis que la pratique du gemmage s'essoufflait et allait bientôt disparaître.
Cette technique, le gemmage “à l’activée”, mise au point en Russie et en Allemagne durant la 1ère guerre mondiale, consistait à pulvériser de l’acide sulfurique sur la carre, à l’aide d’un outil appelé “rainette”. L’acide sulfurique ralentissait la cicatrisation et le pin, en réaction, produisait davantage de résine.
Cette technique, moins respectueuse pour la santé de l’arbre, a coexisté avec le gemmage du système “Hugues” dans l’ensemble du massif gascon jusqu’à sa disparition.
La technique du gemmage en "vase clos"
Plus récemment, Claude COURAU a mis au point la technique du gemmage “en vase clos”. La pique est circulaire et effectuée à l’aide d’une perceuse électroportative. Le gemmeur applique à la blessure un activant avant d’apposer un boîtier hermétique qui guide la résine dans un réservoir étanche, le plus souvent une poche en plastique, parfois un pot en verre.
La distillation de la résine
La distillation de la résine permet d’obtenir deux composants, l’essence de térébenthine et la colophane.
La térébenthine était largement utilisée dans quatre grands domaines: les produits d’entretien, les peintures et les vernis, les produits de synthèse et l’industrie pharmaceutique. Les colophanes servaient dans la fabrication de l'encre noire d’imprimerie, de savons, de linoléums, plastifiants, colles, huiles, graisses industrielles, etc.
La colophane reste indispensable pour tout instrument à cordes frottées.
Le déclin du gemmage en France
En France, le gemmage a décliné progressivement après les années 1950.
Les produits pétroliers, le coût élevé de la main d'œuvre comparé à celui d’autres pays, l’exode de cette main d’oeuvre pendant les grands incendies de la décennie 1940-1950 ont entraîné sa disparition en Aquitaine à la fin des années 80.
Dans les années 1920-1930, apogée de la récolte de la gemme, la filière faisait vivre tout un territoire avec plus de 35000 emplois directs et indirects, du potier au forgeron pour les outils, en passant par les employés de l’usine de distillation, et les gemmeurs bien entendu, sans oublier les chimistes et tonneliers.
Des générations de gemmeurs ont perpétué un savoir-faire qui ne s’apprend ni à l’école ni dans les livres, mais du père et du grand-père.
Renaissance du pot "hugues"
Les larmes de résine ont fini de couler dans les petits pots en terre cuite. Décrochés des flancs des pins, ces milliers de pots ont été tristement abandonnés, oubliés, négligemment jetés au sol, entassés dans la terre qui peu à peu les grignote comme j’ai pu le constater en rentrant en contact avec d’anciennes familles de résiniers ou des propriétaires de ces petits bouts d’histoire.
Ancienne étudiante en Histoire, née un 28 février, le même jour de cette année 1845 où Pierre HUGUES déposa son brevet d’invention, je devais sans doute avoir rendez-vous avec ce morceau de terre superbement patiné par le temps passé pour le faire revivre et vivre une nouvelle destinée.